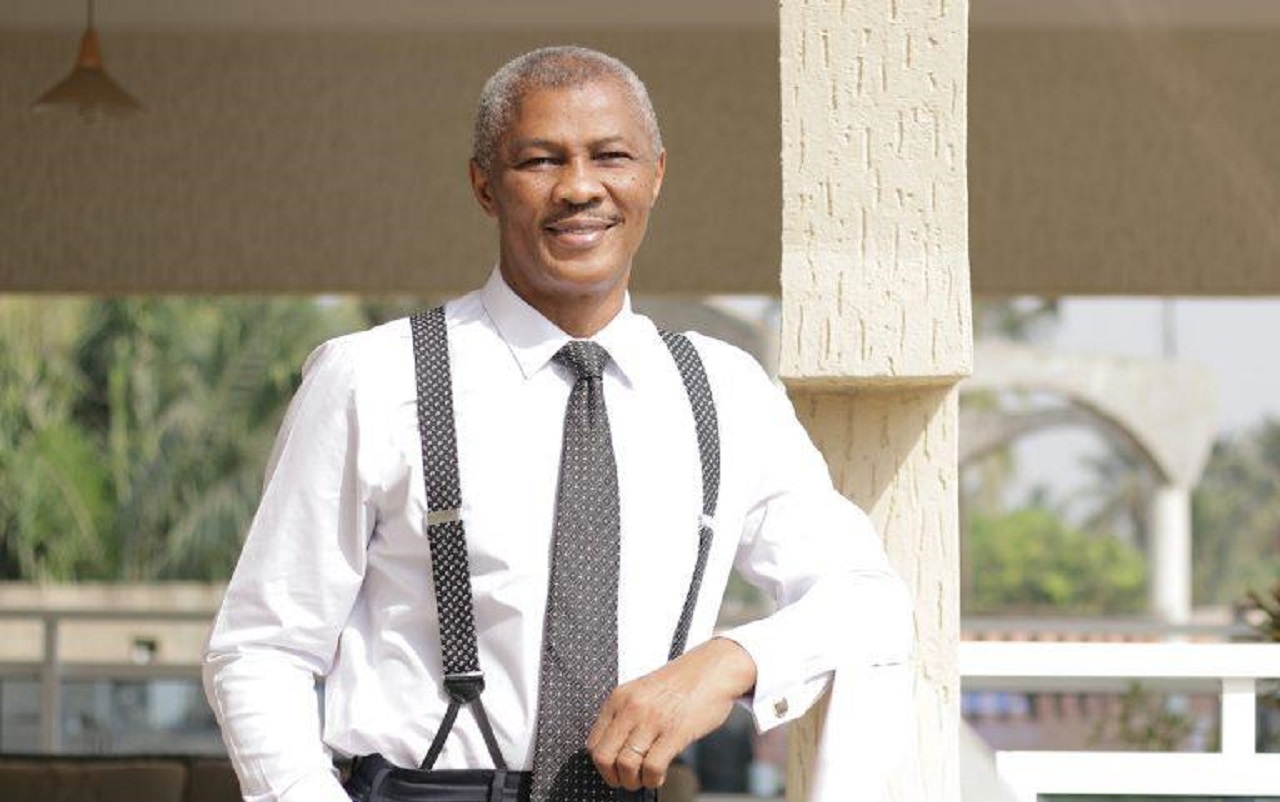Fin septembre 2025, Madagascar a été le théâtre de manifestations massives qui ont rapidement dégénéré en l’une des crises politiques les plus graves de ces dernières années. Inspirés par les mouvements de la « gén Z » les jeunes sont descendus dans les rues d’Antananarivo pour réclamer la démission du président Andry Nirina Rajoelina.
Ces événements ont non seulement mis en évidence de profondes divisions sociales, mais ils ont également ravivé les accusations d’ingérence étrangère, reflétant la méfiance croissante à l’égard des organisations non gouvernementales sur le continent.
La crise à Madagascar s’inscrit dans une histoire politique mouvementée. Andry Nirina Rajoelina, arrivé au pouvoir en 2009 à la suite d’un coup d’État, est confronté à la contestation de sa réélection en 2023 par l’opposition, et sa double nationalité franco-malgache suscite la controverse.
La particularité des manifestations de 2025 réside dans leur caractère spontané et apolitique, similaire à la mobilisation observée au Togo, où des artistes et des personnalités influentes de la diaspora ont appelé à manifester. Le 3 octobre, le président malgache a exacerbé les tensions en publiant une vidéo en direct sur Facebook dans laquelle il accusait des pays étrangers de préparer un coup d’État, sans toutefois les nommer explicitement.
Cette méfiance envers toute ingérence extérieure se reflète clairement dans la position du gouvernement togolais qui, lors d’une conférence de presse en juillet dernier, a condamné « toute tentative de déstabilisation de la sous-région ». Le ministre de l’Administration territoriale du Togo, le colonel Hodabalo Awate, avait alors condamné les « actes de vandalisme » et les « appels à l’émeute », qu’il avait qualifiés de « pure manipulation », des termes qui font étrangement écho aux accusations portées par Antananarivo. La similitude des déclarations témoigne de l’émergence d’une position commune à l’égard de ce qui est perçu comme une nouvelle forme d’ingérence.
Le scepticisme croissant à l’égard des ONG financées depuis l’étranger est un autre point commun entre ces deux situations. Alors que Madagascar souligne le rôle présumé de la France, mentionnant la présence de gendarmes français lors des répressions, le Togo met l’accent sur le financement extérieur des manifestations par des personnalités influentes vivant à l’étranger.
Les deux gouvernements semblent soutenir l’idée d’une stratégie française de « soft power », qui utilise les ONG pour maintenir son influence en Afrique, en particulier après la réduction relative de sa présence militaire. Le lien entre ces crises va au-delà d’un simple parallélisme. Le colonel Awate lui-même a souligné la nécessité de « ne pas dissocier ces événements de ce que nous vivons au Sahel », une région où le Togo renforce sa coopération avec l’Alliance des États du Sahel (AES).
Selon certains analystes, cette orientation politique du Togo, qui inquiète les puissances occidentales, pourrait expliquer les tentatives de déstabilisation dénoncées par les gouvernements des deux pays. Le climat de méfiance renforce les débats sur le « néocolonialisme », dans le cadre desquels les ONG sont considérées comme des instruments permettant aux anciennes puissances coloniales de conserver leur influence.
Par William Mensah