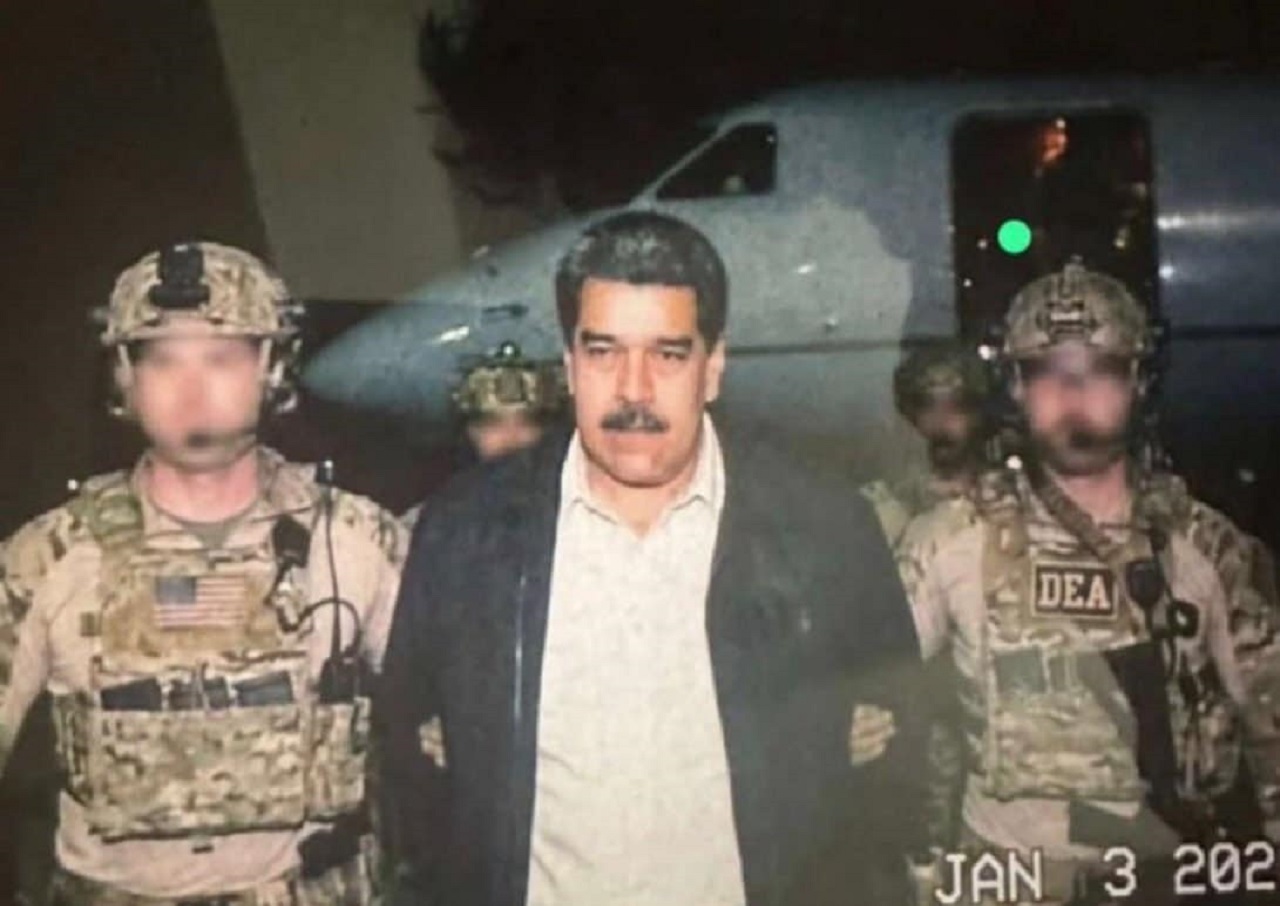La longévité au pouvoir, lorsqu’elle s’accompagne d’une obsession de conservation, modifie profondément la nature de l’action publique. Entre gestion défensive, loyauté érigée en critère absolu et frustration populaire grandissante, c’est toute la dynamique du développement qui s’en trouve étouffée.
Dans les travaux universitaires portant sur les régimes hybrides, deux concepts reviennent avec insistance : la fatigue du pouvoir et le coût politique de la longévité. Ces notions décrivent un phénomène bien connu.Plus un dirigeant concentre ses efforts sur la préservation de son mandat, plus il fragilise les fondations mêmes de sa légitimité. A ce titre, les systèmes démocratiques ont limité la durée des mandats afin de stimuler une saine dynamique.En effet, un chef qui sait que son temps est compté se projette vers la postérité, évalue ses choix et bâtit un bilan.
Pourtant, lorsque l’obsession de se maintenir prend le dessus, l’agenda du développement est relégué au second plan. L’État devient alors un bastion à défendre contre toute menace, réelle ou supposée. Le temps, l’énergie et les ressources sont absorbés par des stratégies défensives plutôt que par des projets de réforme. Dans ce contexte, la compétence n’est plus le premier critère de choix des collaborateurs ; elle cède la place à la loyauté politique, qui devient parfois une monnaie d’échange. Ainsi, on ferme les yeux sur des manquements graves en échange d’un soutien inconditionnel. Ce glissement alimente une culture d’impunité, où l’efficacité est moins récompensée que l’allégeance.
Les projets, même ambitieux et financés à coups de milliards, se vident de leur substance. Les rapports de suivi, au lieu d’être des outils d’évaluation, se transforment en instruments de justification. Convaincu de la fidélité de son entourage, le chef est exposé aux illusions entretenues par ceux qui savent que sa priorité est de garder le pouvoir, non de défendre un programme. Avec le temps, cette mécanique use le dirigeant lui-même. La méfiance s’installe, y compris envers les plus proches, et chaque décision devient une équation politique plutôt qu’un acte de gouvernance.
La conséquence la plus lourde de cette obsession est souvent sous-estimée, car elle touche directement le peuple. La stagnation économique, l’inégalité persistante et la perception d’une impunité généralisée nourrissent une frustration profonde. Peu à peu, les citoyens ne se voient plus comme partenaires du développement, mais comme spectateurs désabusés ou acteurs d’une contestation latente. Dans un climat où la confiance est érodée, chaque revendication sociale est perçue comme une menace ; cela renforce l’usage des moyens de contrôle et détourne encore plus de ressources de la mission première : le progrès national.
L’histoire retient toujours davantage les chefs qui ont préparé leur succession et consolidé les institutions que ceux qui ont prolongé leur mandat sans renforcer l’État. La grandeur politique ne se mesure pas au nombre d’années passées au sommet, mais à la solidité de l’héritage laissé. Reconnaître que la pérennité d’une œuvre politique repose sur la qualité des réformes et non sur la durée personnelle au pouvoir constitue la première étape vers une gouvernance apaisée et durable.
Le Togo, mon beau pays!
Ricardo Agouzou